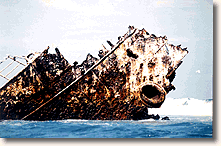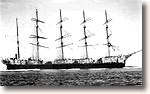Chapitre 3:
La Grande Aventure de FRANCE II
Le Premier Voyage Le 25 novembre 1913, France II, après avoir chargé coke et charbon à Glasgow et fait le plein de passagers, part pour sa première croisière autour du monde, via la Nouvelle-Calédonie. Alors que son départ de la France passe inaperçu, le navire provoque sur son passage en Écosse une admiration unanime. |
|
|
Louis Lacroix raconte lui-même son émerveillement face à ce navire :
«Appelé à Santander en 1912 pour y prendre en charge le trois-mâts "Laënnec" qui avait pris feu en ce port, je m’arrêtais à Bordeaux pour examiner avec le Directeur des Chantiers de la Gironde les possibilités d’y envoyer mon navire en réparations.
A la fin de notre entretien, je fus invité à visiter "France II", alors en achèvement à flot. J’avais, au cours de ma carrière, vu de magnifiques navires et, tout en manifestant mon admiration pour le beau travail accompli par les chantiers bordelais, je ne pus cacher que je m’attendais à voir tout ce qu’on m’avait montré.
Il en fut tout autrement quand je vis le navire terminé en 1913.
Ce géant de la voile, dont les dimensions ne furent jamais égalées, avait été lancé le 9 novembre 1911, au milieu d’une foule énorme et enthousiaste ; mais alors qu’à l’étranger on avait vu l’empereur d’Allemagne en personne monter à deux reprises à bord du cinq-mâts "Preussen", notre gouvernement ignora ce lancement. Les pouvoirs publics semblent se désintéresser de la marine marchande à laquelle ils ne comprennent que peu de chose. Ils oublient que la prospérité et la grandeur d’un pays sont faites des entreprises particulières de chacun de ses enfants.
"France II" était pourtant le plus beau spécimen de tout ce qui avait été fait jusqu’alors.»
("Les derniers cap-horniers français" - Editions Maritimes et d'Outre-mer)
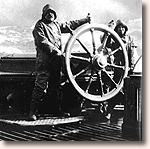 C’est avec un équipage total de 45
hommes seulement que France II prit la mer, ce qui parait
bien peu, proportionnellement au gigantisme de ce
bâtiment.
C’est avec un équipage total de 45
hommes seulement que France II prit la mer, ce qui parait
bien peu, proportionnellement au gigantisme de ce
bâtiment.
C’était dire que les armateurs pariaient sur une
grande maniabilité du navire.
Et ce fut le cas.
« Au cours
de cette première traversée, France II fit preuve de superbes qualités
nautiques. (...) Bien que l’équipage fût, à
proportion, beaucoup plus faible que sur
France I de la maison Bordes, la manœuvre était sans
grands efforts. »
C’est ainsi que s’effectue le premier voyage de France II entre l’Europe et la Nouvelle-Calédonie, avec 92 jours de mer à l’aller et 102 au retour.
Les délais sont un peu dépassés, mais compte tenu des caprices de la mer auxquels il a dû faire face, France II donne entière satisfaction à ses armateurs.
Le pari fait sur ce navire est gagné.
Un épisode relaté par le capitaine en second Lucien Lefèvre, dans son Histoire de la Voile, rend tout à fait compte de l’atmosphère grisante qui régnait à bord du navire lors de cette première traversée, et de la conscience des hommes d’équipage de vivre là une expérience de navigation tout à fait extraordinaire, sur un bateau hors du commun.
|
« A cette époque, j’étais second capitaine à bord du magnifique cinq-mâts barque France, qui accomplissait alors son premier voyage. En plein été austral, le 15 janvier 1914, 51 jours après notre départ de Glasgow, à destination de Thio, en Nouvelle-Calédonie, nous nous trouvions par 46 degrés de latitude sud , dans le « Ouest-Nord-Ouest » des îles Kerguelen, et à quelques 300 milles dans l’est des îlots désertiques du groupe « Marion et Crozet », dont nous avions eu connaissance l’avant veille. Depuis deux jours, fuyant devant le temps, le cul à la lame, à l’allure du grand largue, nous faisions route sous la misaine et nos perroquets fixes. Poussés par le vent et la mer d’une forte tempête de suroît, nous étalions des grains de neige d’une extrême violence, gênant beaucoup la visibilité. En raison de la rencontre toujours possible, en cette saison, de banquises de glace en dérive, la veille sur le gaillard d’avant avait été doublée par un homme de vigie, installé dans le nid de pie, sur les barres du petit perroquet. Comme d’habitude, j’assurais mon quart de 4 à 8h du matin, quand vers 6 heures, dans une éclaircie, entre deux grains de neige, l’homme de veille au bossoir, par trois coups de cloche brefs, me signala : un navire droit devant. Je fis revenir France de 15 degrés sur tribord au vent de notre route et reconnaissait peu de temps après, à un quart sur bâbord à nous, un gros cargo, coque grise et cheminée jaune, aux hautes superstructures blanches, paraissant faire une route sensiblement parallèle à la nôtre. A 7 heures, nous n’étions plus qu’à un mille du vapeur et au moment ou ce dernier arborait comme pavillon de proue les couleurs allemandes, et hissait son numéro de reconnaissance, je pouvais identifier: le Cap- Rocas, paquebot mixte de 12.000 tonnes de la Hambourg-Américain-Line, assurant un service régulier sur Le Cap et l’Australie.. Notre capitaine, M. Victor Lagniel, auquel me liait une sincère et solide amitié, ayant passé une grande partie de la nuit sur le pont, se reposait tout botté sur le canapé de sa chambre de veille. Je le mis rapidement au courant du temps et de la situation, tout en lui faisant bien remarquer que le vapeur en vue semblait pousser dur ses feux avec l’intention évidente d’essayer de nous étaler en vitesse. En effet, d’énormes volutes de fumée noires immédiatement tordues, effilochées et dispersées par la bourrasque sortaient de sa haute cheminée.» En langage marin, la décision ne se fit pas attendre : « De la toile Lefèvre ; tout le monde sur le pont ; établissez moi la grand’voile avant et montrez lui le cul. En raison du fait toujours exceptionnel de la rencontre d’un navire dans ces parages peu fréquentés par les vapeurs, les hommes de la bordée, non de quart, étaient déjà en grande partie montés sur le château, et aussitôt le commandement donné de: Tout le monde sur le pont, paré à la manœuvre, et l'ordre de larguer la grand'voile, les hommes de ma bordée, qui n’attendaient que cela, étaient déjà sur la vergue., à dérabanter la toile, pendant que les tribordais, aux accents cadencés de la vieille chanson de mer Il était une frégate, martelant le pont de leurs lourdes bottes, viraient au cabestan double l’écoute de la grand’voile. Effectivement le Cap-Rocas poussait sa pression au maximum... A 7h15, toutes ses soupapes de sûreté soulagées crachaient à plein jet leur vapeur blanche. Mais son compte était déjà réglé. A 7h30, d’accord avec mon capitaine, je donnais l’ordre de larguer la portion sous le vent de la grand’voile centrale, qui fut bordée et établie, avec tout le soin et les précautions qu’exigeait l’état du temps. Tous mes hommes, jeunes et vieux, manœuvraient dans un état d’excitation très facile à concevoir... A 8h du matin, notre pavillon national battant à la corne d’artimon, au-dessus de notre signal distinctif, les couleurs de nos armateurs en tête du grand mât central, deux timoniers de choix à la barre, nos 56 hommes d’équipage bottés et cirés capelés, parés à manœuvrer, alignés tout au long des lisses bâbord, de la dunette arrière, enthousiasmés par une telle lutte au milieu des éléments déchaînés, répondaient par trois hourras frénétiques aux saluts et aux acclamations de l’équipage et des passagers du paquebot. Alors, laissant porter de 15 degrés sur la gauche pour reprendre notre route primitive, France forçant de toile, sous les rafales d’un grain violent, prenant de la bande, ses pavois dans l’eau et ses ponts balayés par la mer, mais solide comme un roc, à 150 mètres sur son tribord, défila au vent de l’Allemand à 18 nœuds de vitesse (vitesse officiellement enregistrée). Quand nous franchîmes son travers, prévenant notre geste, Cap-Rocas nous salua très courtoisement du pavillon, appuyant son salut par trois coups de sa puissante sirène, pendant que de sa passerelle de commandement montaient séparément, aux drisses de marocain, les trios signaux de l’ancien code international: ZC...ZD...T.D.L. Traduisez par: superbe, admirable, je vous souhaite bon voyage. Nous saluâmes à notre tour, amenant par trois fois nos couleurs à hauteur de la crête des lames, pendant qu’à la cornette d’artimon montaient les trois pavillons de l’ancien signal: XOR - je vous remercie. A 8h30, notre regretté capitaine avait sujet d’être entièrement satisfait. De sur la passerelle haute du grand vapeur, les jumelles allemandes pouvaient lire sur le tableau de notre couronnement arrière, au-dessus des armes blasonnées de notre port d’attache, en grosses lettres dorées : « France- Rouen ». Alors, spontanément, dans un sursaut d’orgueil compréhensible, tout l’équipage réuni au pied du mât d’artimon, face à l’arrière, par la voix de stentor de son premier maître, manifesta à son chef sa confiance, sa grande satisfaction et sa joie: « Vive le capitaine du cinq-mâts France. Bonne chance et bonne traversée pour lui, pour son état-major et tout son équipage ». Vieille formule d’antan, ponctuée par trois nouveaux hourras poussés à pleine gueule, pour essayer de dominer la grande voix du vent. Nous étions fiers de notre belle manœuvre, mais fiers surtout de la barque que nous avions sous les pieds, et de la nouvelle performance que nous venions d'inscrire au palmarès des clippers de France. Après un nouveau et dernier salut, nous continuâmes notre route. Toute la matinée les grains redoublèrent de violence, mais on étala la toile. A midi, le Cap-Rocas n’était plus dans les éclaircies qu’un point noir, sur l’horizon de l’ouest. Pendant le petit quart de 16 à 18h, le temps gardant toujours mauvaise apparence et les vents ayant tendance à hâler le sud, par mesure de prudence les deux basses voiles furent à nouveau carguées et serrées sous rabans, pour la nuit... Voici, dans toute son intégrité, un souvenir vécu....Un exemple parmi bien d’autres qui, au temps de la navigation à voile, faisait battre à l’unisson les cœurs d'un capitaine, de ses officiers et de son équipage , car tous ces hommes à la vie si spéciale et quasi monastique, dans leur superbe isolement, avaient eu une conception toute particulière de leurs devoirs, et sous l’écorce de leur rude nature se montraient très sensibles à la satisfaction de ce devoir accompli. Au changement de quart, l’équipage reçut double ration de vin, une ration de café, de sucre et de tafia supplémentaire, et l’ordinaire fut amélioré. Aussi, dans les postes d’équipage, autour des tables, devant les quarts en fer blanc, beaucoup d’exubérance et nombreux commentaires sur les événements du matin. » |
Changement de cap...
Henri Prentout mort, la Société des Navires Mixtes décida, fin 1916, de se séparer de France II, estimé trop peu rentable par la compagnie : les difficultés liées à la guerre, le contrat avec la Société Le Nickel jugé trop onéreux, et un problème de moteur au retour du quatrième voyage eurent raison de lui.
France II entrait dans une nouvelle phase de son histoire, au sein de la Compagnie Française de Marine et de Commerce.
On arma le navire de deux canons.
Le 21 février 1917, France II partit de Glasgow avec un plein chargement de charbons à destination de Montevideo et entama une campagne mouvementée qui devait durer deux ans, le menant des ports de la côte américaine à ceux de l’Australie, de la Nouvelle-Calédonie et enfin à Dakar, avant de revenir à Bordeaux le 17 février 1919 et d’aller désarmer au Havre.
France II avait tout transporté : des graines, du suif, des cuirs, des cafés, de l’essence, du nickel, des billes d’acajou, des arachides; et avait surmonté toutes les épreuves : attaques allemandes, incendie, icebergs, cyclone...
Des discussions s’engagèrent à propos des deux moteurs diesel de France II, qui ne donnaient pas entière satisfaction aux nouveaux armateurs.
|
... avec un nouveau capitaine et un équipage étendu à plus de cinquante hommes.
Première alerte...
Dès le premier voyage, à l’été 1919, un incident survint : un violent coup de vent obligea le remorqueur anglais, qui devait le mener jusqu’à l’entrée de la Manche, à l’abandonner.
D’après les dire du capitaine du remorqueur, qui avait laissé France II couché sur le côté, probablement à cause d’un mauvais arrimage des marchandises, on crut le navire perdu.
Il n’en fut rien. Et si Lacroix note au passage que l’arrimage des marchandises à cette époque sur les grands voiliers n’était plus effectué dans les règles de l’art, il n’en reste pas moins que France II, sauvé pour cette fois, continua à effectuer son travail de transporteur vers le Nord-Ouest américain jusque 1921, puis un voyage pour la Nouvelle-Zélande.
« Simple voilier, le cinq-mâts faisait des traversées presque aussi belles que celles effectuées avec l’assistance des moteurs. »
Le dernier voyage.
C’est pourtant faute de moteur que France II s’échoua, dans la nuit du 11 au 12 juillet 1922, sur le récif de Ouano en Nouvelle-Calédonie, vers laquelle il avait effectué de si nombreux voyages.
Le vent l’avait abandonné, et une mer houleuse avait fait le reste.
|
« L’Australian Salvage Cie envoya un des puissants remorqueurs de la société sur les lieux; son représentant estimait le sauvetage très possible, mais les frets avaient baissé, la marine marchande était dans le marasme, les navires se vendaient à vil prix, ceux qui étaient obligés de naviguer le faisaient à perte. L’abandon du France II fut décidé. » |
|
Dépouillé de tout ce qui pouvait être récupérable, on vendit sa coque comme épave, laquelle est encore visible aujourd’hui, pitoyable vestige d’une fin peu glorieuse. |
Trois mois après le naufrage, l'hebdomadaire l'Illustration consacrait un article au naufrage:
|
||||||||||||||||||||
« Telle fut la fin du plus grand navire du monde, l’orgueil de nos chantiers et de notre marine à voile... »